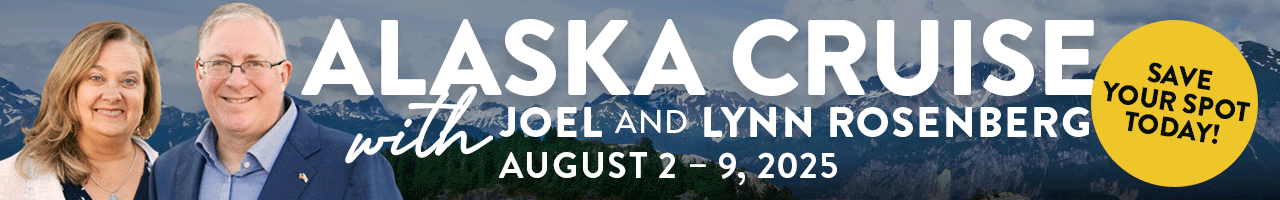Suspicions interconfessionnelles

C'est sans doute la saison des rassemblements interconfessionnels. Deux d'entre eux ont eu lieu récemment, l'un au bord de la mer Morte et l'autre à Ein Rafa, un village arabe situé à l'ouest de Jérusalem.
« Un iftar pour tous », écrit par Mohamad M. Jamous, qui se définit comme un militant palestinien pour la paix et un dirigeant communautaire de Ramallah, décrit en détail un événement interconfessionnel, près de la mer Morte, où un millier de juifs, de musulmans, de chrétiens et de samaritains se sont réunis, malgré les divisions politiques et religieuses.
Le point commun était « que la justice, l'égalité, la liberté et la sécurité sont les droits de chaque être humain sur la terre ».
Si tout cela sonne bien à l'oreille de ceux qui recherchent l'unité et la solidarité, il est difficile d'adhérer à cet effort sans d'abord parvenir à une certaine compréhension de base des positions, des intérêts et des aspirations futures des uns et des autres. En effet, dans ce grand moment de photo et de bien-être, comment cela fonctionne-t-il si certains des participants soutiennent un groupe, tel que le Hamas, dont les objectifs sont la destruction de la patrie d'autres participants ?
L'initiative interconfessionnelle, baptisée « Projet des enfants d'Abraham », semble partir du principe que tout le monde est sur un pied d'égalité et s'engage à assurer la justice, l'égalité, la liberté et la sécurité pour chaque homme, chaque femme et chaque enfant, indépendamment de sa foi, de son appartenance ethnique ou d'autres différences. S'il s'agit d'un objectif noble et vertueux, il n'est pas nécessairement partagé par tous.
Les juifs, ainsi que les chrétiens, seraient heureux de vivre parmi tous les autres, en respectant le droit de chacun à vivre et à laisser vivre, mais on ne peut pas en dire autant de tous les musulmans. Malheureusement, les plus extrémistes, qui croient que toute créature doit être soumise à l'autorité et à la domination de l'islam, ne sont pas attachés aux idéaux de respect mutuel.
Jamous fait l'éloge de la coexistence qui a été démontrée lors de cet événement, promouvant la paix entre les « différentes religions et communautés ». Mais y a-t-il eu des discussions substantielles ou approfondies qui auraient mis en lumière les différences énormes et profondes entre chacun de ces groupes ? Probablement pas, car ces différences n'auraient servi qu'à saper l'espoir d'une unité imaginaire, qu'ils espéraient atteindre.
Mais il est difficile de nier que les doctrines et les philosophies issues d'une foi extrême sont généralement destinées à un groupe de personnes qui se considèrent comme les seuls détenteurs de la vérité et qui ont le dernier mot sur la façon dont ils croient que Dieu leur a demandé d'agir. Ainsi, bien que cela fonctionne pour eux, les autres sont souvent relégués au rang de barrières ou d'obstacles au type d'utopie que le groupe extrémiste prétend possible si seulement tout le monde se soumettait à sa marque.
Mais aucun de ces éléments n'a vraisemblablement été discuté lors de ce rassemblement, qui a cherché à dissimuler les disparités gênantes qu'il vaut mieux oublier afin d'obtenir le « vivre ensemble » qui est tout l'intérêt du nom, « les enfants d'Abraham », parce qu'Ismaël et Isaac appartiennent tous deux à cette catégorie.
Mais le problème commence lorsque les fils d'Ismaël ouvrent le livre commun aux juifs et aux chrétiens, l'Ancien Testament, appelé aussi Tanach, qui distingue ces deux garçons, tous deux issus de la descendance d'Abraham. C'est dans ces écrits que l'on constate une inégalité qui va à l'encontre du type de règles du jeu équitables préconisées par les efforts interconfessionnels.
Au verset 19 de la Genèse 17, il est dit que Dieu établira son alliance avec Isaac et non avec Ismaël, en dépit du fait qu'il deviendra lui aussi une grande nation grâce à ses descendants. Mais la promesse serait réalisée par Isaac et ses descendants.
Cela n'est pas conforme aux enseignements de l'islam, qui proclame que ceux qui n'adhèrent pas à ses principes sont des infidèles.
Alors, comment concilier ces chemins divergents dans un contexte de coexistence - il suffit de ne pas en parler ? Vous pouvez y parvenir pour un événement d'une nuit ou même d'un week-end, mais lorsque chacun retourne dans son coin, ces distinctions deviennent une réalité.
Le rassemblement d'Ein Rafa, qui coïncidait également avec la fête musulmane du Ramadan, en a été un exemple. Lorsque la question de la coexistence et de la diversité, suite au massacre du 7 octobre, a été posée, les orateurs sont restés silencieux.
Il est facile d'ignorer l'éléphant dans la pièce, pour ainsi dire. Il suffit de le dissimuler en vantant les mérites de ceux qui ont fait des heures de route pour participer à cet événement ou en glorifiant les étonnants orateurs qui sont montés sur scène et les belles prières qui ont été prononcées au coucher du soleil, accompagnées du son du shofar, pour compléter l'illusion de l'unité.
Tout cela était un prélude à l'« iftar », le nom donné au repas du soir, pris pendant la fête musulmane du Ramadan, lorsque le jeûne quotidien est rompu par un somptueux repas le soir. Selon Jamous, les juifs et les chrétiens ont également pris part au jeûne, sans doute dans un geste unificateur, car il ne s'agit pas de leur coutume, mais plutôt d'un acte interconfessionnel qui, dans ce cas particulier, s'est avéré être une adhésion à l'islam.
La question est de savoir ce que ce type d'événement accomplit réellement, à part une manifestation temporaire de bonne volonté. Ceux qui participent à ce type d'exposition le font probablement pour créer l'image que tous ces groupes divers peuvent favoriser quelque chose de positif tout en se respectant les uns les autres en reconnaissant leurs différences. Cela part peut-être d'une bonne intention, mais c'est méconnaître les énormes fossés qui séparent les religions et qui sont à l'origine des nombreuses guerres et luttes qui ont jalonné l'histoire de l'humanité.
Dans un monde parfait, tout le monde se respecterait, mais, malheureusement, nous ne vivons pas dans un monde parfait. Au contraire, nous vivons dans un univers rempli de querelles, d'envie, de colère, de jalousie, de haine et de toutes les autres formes de mal qui existent.
Ce n'est que par le biais d'une foi véritable, dont l'auteur est un Dieu aimant et miséricordieux, que nous sommes en mesure de surmonter les pires et les plus vils penchants auxquels chacun d'entre nous peut sombrer. Tous les efforts interconfessionnels n'effaceront pas ces mauvaises pulsions. Seul le fait de se tourner vers notre Créateur peut nous amener à abandonner le mal et à choisir la justice.
L'événement de la mer Morte, présenté comme « un pas courageux vers un avenir défini par le dialogue au lieu de la violence et par la coopération au lieu de l'hostilité », n'est qu'un effort pour contourner le Tout-Puissant et parvenir à un lieu de plénitude par nos propres moyens ou, comme l'appelle Jamous, « un effort collectif ».
Aucun iftar ne peut atteindre ces objectifs, car le fossé est tout simplement trop grand. Tant que nous ne nous tournerons pas vers notre Créateur, ces efforts humanistes resteront en deçà de la paix sur terre que chacun d'entre nous recherche.

Ancienne directrice d'école primaire et de collège à Jérusalem et petite-fille de Juifs européens arrivés aux États-Unis avant l'Holocauste. Ayant fait son alya en 1993, elle est à la retraite et vit aujourd'hui dans le centre du pays avec son mari.